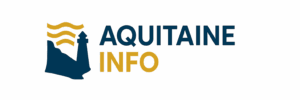Dans les Landes, la découverte en novembre 2025 du nématode du pin à Seignosse a placé la forêt landaise face à un défi sans précédent. Ce parasite, minuscule mais redoutable, s’attaque aux pins maritimes en bloquant la circulation de la sève, menant à la mort rapide des arbres touchés. Son introduction en France marque un tournant préoccupant pour l’un des plus vastes massifs forestiers d’Europe. Les autorités, épaulées par les chercheurs de l’Inrae et l’ensemble de la filière bois, ont enclenché un plan d’urgence pour enrayer sa propagation. Entre mesures réglementaires strictes, zones tampons étendues et surveillance renforcée, la filière bois et les collectivités locales font bloc pour préserver un patrimoine végétal et économique majeur de la région. Cette mobilisation sans relâche s’inscrit dans une course contre la montre, alors que le parasite menace déjà de franchir d’autres frontières naturelles, posant la question de l’efficacité des dispositifs de limitation et de leur pérennité face à l’ampleur de l’invasion.
- Détection inédite du nématode du pin en France : Le parasite a été identifié pour la première fois sur le territoire national, à Seignosse, dans les Landes.
- Propagation redoutée : Favorisée par le coléoptère monochamus galloprovincialis, sa diffusion rapide menace les massifs de pins.
- Mesures d’urgence : Abattage ciblé, surveillance étendue sur une zone de 20 km et restrictions sur le transport de bois ont été engagés.
- Enjeux économiques et environnementaux majeurs : La filière bois et les acteurs locaux se mobilisent pour éviter une crise écologique et industrielle.
- Course contre la montre : Le retrait des arbres infestés doit s’opérer avant la prochaine saison d’activité de l’insecte vecteur.
Menace du nématode du pin : premiers constats et enjeux pour les Landes
Détecté pour la première fois en France début novembre, le nématode du pin représente une menace inédite pour la forêt landaise, déjà fragilisée par plusieurs épisodes de sécheresse ces dernières années. Ce parasite, originaire d’Amérique du Nord, s’attaque spécifiquement aux pins maritimes, piliers économiques et écologiques de la région. Reconnue pour son rôle dans la préservation de la biodiversité et pour son importance pour la filière bois, la pinède landaise voit aujourd’hui son équilibre mis à rude épreuve.
- L’apparition du nématode a entraîné l’activation immédiate d’un protocole de prévention par les autorités locales.
- Le réseau de surveillance épidémiologique régional a identifié le secteur de Seignosse comme zone à risque très élevé.
- L’enjeu dépasse les frontières des Landes, puisqu’une zone tampon s’étend désormais jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques.
| Espèce touchée | Méthode de dispersion | Zone de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|---|
| Pins maritimes | Monochamus galloprovincialis (insecte vecteur) | Landes, Pyrénées-Atlantiques | Affaiblissement massif forestier |
La vigilance s’explique par la virulence du parasite mais aussi par les conditions météorologiques qui, comme l’illustrent les récents épisodes de sécheresse (voir ce dossier), affaiblissent les pins et facilitent l’installation des ravageurs. Ainsi, le contexte local ne fait qu’augmenter la vulnérabilité des forêts.
Comment le nématode du pin se propage et pourquoi la lutte s’avère difficile
Le cycle de propagation repose sur un coléoptère xylophage, le monochamus galloprovincialis. À l’émergence du printemps, ces insectes porteurs du parasite se déplacent de pin en pin, transmettant le nématode durant une période qui peut s’étendre sur dix semaines. D’après les travaux de l’Inrae, la distance de dispersion du foyer initial atteindrait jusqu’à neuf kilomètres dans des massifs homogènes de pins, accentuant le risque d’expansion rapide.
- La transmission débute dès l’éclosion de l’insecte vecteur au printemps.
- La période d’activité maximale de diffusion s’étale sur environ deux mois.
- L’efficacité de la lutte dépend largement de la rapidité d’intervention à la sortie de l’hiver.
| Période clé | Barrière naturelle éventuelle | Mobilisation technique |
|---|---|---|
| Printemps (mars-mai) | Climats frais, diversité végétale | Abattage préventif, modélisation propagation |
Dans ce contexte, la moindre hésitation dans la mise en œuvre des mesures peut se traduire par une propagation accélérée du parasite à l’échelle régionale. La filière bois, confrontée à une menace similaire à ce qui a déjà été observé au Portugal ou en Espagne, s’appuie désormais sur les retours d’expérience de ces pays pour adapter sa stratégie.
Des stratégies de lutte centrées sur la prévention et la réactivité
La réglementation européenne impose des mesures drastiques : destruction systématique des arbres sensibles dans un périmètre de 500 mètres autour d’un foyer et surveillance renforcée jusqu’à 20 kilomètres. Cette approche, éprouvée mais parfois jugée insuffisante, doit néanmoins tenir compte de la capacité du parasite à franchir ces barrières via son insecte vecteur. Dès novembre, la préfecture des Landes a réuni l’ensemble de la filière bois, les élues locales, chercheurs et services de l’État pour coordonner l’application du protocole de lutte, avec un accent net sur la prévention.
- Interdiction du transport de tout bois potentiellement contaminé hors de la zone.
- Saturation des parcs à végétaux interdits de broyage pour éviter la dissémination.
- Initiatives de cartographie et d’identification de chaque foyer suspect dans la zone sud du département.
| Action | Objectif principal | Parties prenantes |
|---|---|---|
| Abattage ciblé | Éliminer la source de propagation | Entreprises forestières, collectivités |
| Surveillance épidémiologique | Détecter de nouveaux foyers rapidement | Inrae, services de l’État, filière bois |
| Restrictions de circulation | Limiter la dissémination mécanique | Transporteurs, exploitants forestiers |
Les pouvoirs publics et les responsables de la filière soulignent que chaque décision est calibrée pour anticiper la saison d’activité du coléoptère vecteur. Retirer les arbres infestés avant mars permettrait d’arrêter la chaîne de contamination avant sa reprise au printemps.
Consultez les détails des mesures mises en place pour suivre l’évolution de la situation dans les Landes.
Vers une surveillance accrue et modélisation de la menace
L’identification d’un foyer constitue un signal d’alarme renforçant la nécessité d’affiner la surveillance et de modéliser avec précision les trajectoires de propagation potentielle. L’Inrae, fortement mobilisée, s’appuie sur ses modèles développés depuis plus de quinze ans, adaptant les scénarios en fonction des nouvelles données récoltées localement. Des hypothèses complexes sont testées pour déterminer les zones d’intervention prioritaires et anticiper les impacts futurs.
- Les données de propagation issues du Portugal et de l’Espagne servent à optimiser les plans d’action.
- L’expérience internationale montre qu’aucun pays n’a encore éradiqué le parasite une fois implanté durablement.
- Des outils de simulation sont employés pour prioriser l’abattage et la surveillance selon les habitats forestiers.
| Pays concerné | Année de détection | Situation actuelle | Mesures prises |
|---|---|---|---|
| Japon | 1900 | Propagation nationale | Surveillance, abattages, reboisement |
| Portugal | 1999 | Propagation quasi intégrale | Restriction du bois, zones tampons |
| France (Landes) | 2025 | Foyer localisé, alerte maximale | Abattage, interdictions de transport |
La constitution de zones tampons autour du foyer repéré à Seignosse et l’intégration de tous les maillons de la filière bois témoignent de la réactivité régionale face à la propagation potentielle. Par ailleurs, les fermetures progressives des parcs à végétaux dans les déchetteries sont issues des recommandations des experts pour limiter la dissémination lors du compostage ou du broyage.
Qu’est-ce que le nématode du pin et pourquoi est-il dangereux ?
Le nématode du pin est un ver microscopique qui bloque la circulation de la sève dans les pins maritimes, provoquant leur dépérissement rapide. En l’absence de traitement, sa propagation plonge des massifs entiers dans la fragilité ou la mort.
Comment le nématode du pin est-il arrivé en France ?
Selon la plateforme d’épidémio-surveillance, l’introduction serait due aux transports de bois contaminé depuis le Portugal ou l’Espagne, où le parasite s’est déjà largement implanté.
Quelles mesures ont été prises immédiatement dans les Landes ?
Dès la détection du foyer, les autorités ont déclenché l’abattage des arbres sensibles dans les zones touchées, interdit le broyage des végétaux à risque et fermé certains parcs à végétaux pour éviter toute dissémination.
Le nématode du pin peut-il être éradiqué ?
Aucun pays n’a réussi une éradication totale une fois le parasite implanté. Cependant, une intervention rapide et coordonnée permet parfois de juguler les foyers initialement limités.
Comment rester informé de l’évolution de la lutte dans les Landes ?
Les sites d’actualité régionaux tels que Aquitaineinfo ou les bulletins de la préfecture des Landes diffusent régulièrement les nouvelles mesures et l’état de la situation.
Source: www.20minutes.fr