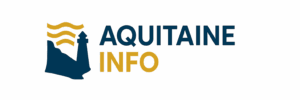Il y a 80 ans, les fermiers landais ont commencé à voir basculer leur destin, jusque-là marqué par la rudesse du métayage. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la région des Landes fut le théâtre d’une véritable révolution sociale, lorsque le décret d’octobre 1945 et la loi d’avril 1946 posèrent les fondations de la fin d’un système inégalitaire vieux de plusieurs siècles. Ce contexte de bouleversements a marqué profondément la société, cristallisant des tensions, mais ouvrant la voie à de nouveaux droits pour des milliers d’exploitants agricoles. Ce tournant historique, au cœur d’une France reconstruite, est jalonné de résistances locales, d’affrontements, et d’acteurs politiques déterminés. Aujourd’hui encore, ce cri de justice résonne dans le tissu social et culturel des Landes, alimentant les réflexions sur l’équité, l’accès à la terre, ainsi que l’identité territoriale.
La disparition du métayage : un bouleversement pour les fermiers des Landes
Dans les années suivant la Libération, l’ordonnance du 17 octobre 1945 a sonné la fin progressive du métayage, une forme d’organisation agricole ancrée depuis des générations dans les Landes. Ce système plaçait les métayers au service de grands propriétaires terriens — les lou meste — qui détenaient de vastes domaines. Les métayers ne conservaient qu’une modeste part du fruit de leur travail, générant précarité et dépendance. La conversion du métayage en fermage a impulsé la possibilité de devenir pleinement exploitants, ouvrant l’accès à la terre pour ceux qui la travaillaient quotidiennement.
- Fin des corvées gratuites imposées aux métayers.
- Suppression des redevances excessives prélevées au profit des propriétaires.
- Introduction du droit à la conversion du métayage en fermage sur simple demande.
- Droit de préemption pour les exploitants agricoles.
- Montée en puissance de l’idéal « la terre à celui qui la travaille ».
| Avant 1945 | Après l’ordonnance de 1945 |
|---|---|
| Partage du travail et des récoltes très inégalitaire | Partage « deux tiers-un tiers » en faveur du fermier |
| Corvées et dote au propriétaire | Suppression des corvées |
| Aucune sécurité du foncier | Droit de préemption et accès facilité à la propriété ou au fermage |
Ce nouvel équilibre fut obtenu au terme de longues confrontations politiques et sociales, dont témoignent les rassemblements massifs et parfois tendus dans les bourgs comme Pouillon ou Narrosse. L’accès à la justice et l’amélioration des droits économiques étaient au cœur de la mobilisation, comme en témoignent les nombreuses initiatives recensées dans la région, comparables sur certains aspects à d’autres luttes contemporaines, telles que les affaires de biens agricoles disputés ou les conflits de propriété dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le mouvement social et les figures de la résistance rurale
À partir de la fin 1945, la lutte contre le métayage a mobilisé aussi bien la base agricole que l’arène politique. Plusieurs députés, tels que Charles Lamarque-Cando ou Félix Garcia, ont incarné ce combat. Les actions collectives sont restées marquées par des meetings houleux, des affrontements avec les forces de l’ordre et une solidarité entre métayers tenant tête aux tentatives d’expulsion. Dans certaines localités, ce sont des milliers de personnes qui se regroupaient pour résister aux propriétaires réfractaires aux nouvelles règles. Ces événements mettaient en lumière la persistance d’un ordre ancien encore solidement ancré dans la région.
- Assemblées populaires et débats sur l’équité foncière
- Soutien appuyé des élus de gauche et des syndicats agricoles
- Publications d’ouvrages documentant la lutte paysanne
- Actions de solidarité dans la région Sud-Ouest
- Mise en avant de la figure du métayer comme symbole de l’émancipation rurale
| Localité | Action notable | Acteurs principaux |
|---|---|---|
| Pouillon | Meeting et affrontements avec la police | Fermiers, syndicats, élus locaux |
| Narrosse (près de Dax) | Obstruction à des expulsions | Résistants locaux, députés de Gauche |
| Haute-Lande, Chalosse | Solidarité communautaire lors des expulsions | Familles rurales, associations agricoles |
La portée de ces actions dépasse la seule question foncière. Les débats qui traversaient alors le monde rural landais sont comparables à d’autres enjeux contemporains, comme ceux de la gestion des migrations dans le Pays Basque ou de l’accès à la propriété dans des affaires immobilières complexes.
L’évolution du droit rural et l’impact durable sur la société landaise
L’institution du fermage et la fin progressive du métayage ont représenté plus qu’une victoire sociale : elles ont redéfini les rapports économiques et juridiques entre exploitants et propriétaires dans les Landes. Les textes législatifs de l’époque prévoyaient de nouveaux droits essentiels, tels que la possibilité de demander la conversion du bail en fermage ou celle de préempter en cas de vente. Le partage à parts plus égales des récoltes, associé à la suppression des charges injustes, a permis une stabilisation de la situation financière pour des centaines de familles rurales. Parallèlement, le secteur agricole local s’est engagé dans une modernisation inédite, tirant profit d’un accès facilité au crédit et à l’innovation.
- Amélioration des conditions de vie des fermiers
- Stabilité juridique et économique accrue pour les familles rurales
- Déclin des grandes exploitations au profit de la petite agriculture familiale
- Naissance d’organismes de gestion du foncier rural
- Apparition de nouvelles solidarités entre agriculteurs
| Droit acquis | Conséquence | Durée d’application |
|---|---|---|
| Conversion en fermage | Indépendance accrue du fermier | Jusqu’à aujourd’hui |
| Suppression des corvées | Meilleure qualité de vie | Permanent |
| Droit de préemption | Favorise l’installation des jeunes exploitants | Renouvelé en 2025 |
Si les mouvements d’hier trouvent encore écho aujourd’hui, il subsiste des défis relatifs à l’inclusion et à l’accès à la justice, qu’ils soient liés aux difficultés rencontrées par les sans-abri comme à Boucau (lire ici) ou aux enjeux liés à l’immigration rurale (détails).
Le retentissement du cri de justice dans la mémoire et l’actualité landaise
La mémoire de ces luttes continue d’investir les débats locaux, que ce soit à travers des ouvrages historiques, des rencontres associatives, ou les pratiques agraires contemporaines. L’expérience landaise s’invite également dans les réflexions sur la justice, aux côtés d’autres problématiques sociales, telles que la question des droits des employés ou la gestion des violences conjugales à Dax. Les institutions judiciaires locales, témoin du passage d’une ère à une autre, témoignent d’une volonté constante de garantir l’équité, l’accès aux droits et la protection des plus vulnérables.
- Ouvrages de référence sur l’histoire paysanne
- Archives judiciaires consultées pour enrichir l’historiographie
- Programmes éducatifs sur les luttes sociales locales
- Initiatives associatives pour défendre la mémoire rurale
- Dialogue renouvelé entre population rurale et élus
| Thème | Exemple d’initiative récente | Portée |
|---|---|---|
| Mémoire paysanne | Publication d’ouvrages historiques | Régionale |
| Justice rurale | Numérisation des archives des procès fonciers | Départementale |
| Éducation et jeunes agriculteurs | Programme d’accueil dans les exploitations familiales | Locale |
L’étude de cet épisode demeure une clé de compréhension des rapports sociaux dans les Landes, où la quête de justice territoriale anime encore les nouvelles générations, y compris lors d’événements judiciaires récents tels que l’affaire Rivehaute ou la gestion soucieuse des archives du crime.
{« @context »: »https://schema.org », »@type »: »FAQPage », »mainEntity »:[{« @type »: »Question », »name »: »Quu2019est-ce que le mu00e9tayage et pourquoi a-t-il pris fin dans les Landes ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Le mu00e9tayage u00e9tait un contrat agricole ou00f9 le paysan, appelu00e9 mu00e9tayer, exploitait une terre appartenant u00e0 un propriu00e9taire, remettant une grande part de la ru00e9colte u00e0 ce dernier. Ce systu00e8me a u00e9tu00e9 aboli pour limiter les injustices et donner plus de droits aux travailleurs de la terre gru00e2ce u00e0 lu2019ordonnance de 1945 puis la loi de 1946 dans les Landes. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quels ont u00e9tu00e9 les principaux changements apportu00e9s par la loi de 1946 ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »La loi de 1946 a instauru00e9 le partage plus u00e9galitaire des revenus agricoles, supprimu00e9 les corvu00e9es obligatoires, permis la conversion du mu00e9tayage en fermage sur simple demande et a donnu00e9 un droit de pru00e9emption aux exploitants agricoles landais. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Pourquoi y a-t-il eu des tensions lors de lu2019application de ces ru00e9formes ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Lu2019application de la ru00e9forme a suscitu00e9 des conflits car elle remettait en cause les privilu00e8ges des grands propriu00e9taires fonciers. Des meetings, des affrontements et des actions collectives ont eu lieu, en particulier u00e0 Pouillon et Narrosse, entrau00eenant parfois des interventions policiu00e8res. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quels sont les liens entre la lutte des mu00e9tayers landais et les enjeux sociaux actuelsu202f? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »La lutte pour la justice fonciu00e8re dans les Landes trouve une ru00e9sonance dans les du00e9bats contemporains sur lu2019accu00e8s aux droits, la ru00e9partition des richesses et la gestion des biens communs, tout comme les conflits actuels liu00e9s u00e0 lu2019immobilier ou u00e0 la migration. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Comment ce passu00e9 influence-t-il encore la sociu00e9tu00e9 landaise aujourdu2019huiu202f? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Cet u00e9pisode a forgu00e9 une conscience collective autour de lu2019u00e9quitu00e9 territoriale et de la solidaritu00e9 rurale, qui se manifeste encore dans les du00e9bats sur la justice, lu2019identitu00e9 locale et la gestion du patrimoine foncier. »}}]}Qu’est-ce que le métayage et pourquoi a-t-il pris fin dans les Landes ?
Le métayage était un contrat agricole où le paysan, appelé métayer, exploitait une terre appartenant à un propriétaire, remettant une grande part de la récolte à ce dernier. Ce système a été aboli pour limiter les injustices et donner plus de droits aux travailleurs de la terre grâce à l’ordonnance de 1945 puis la loi de 1946 dans les Landes.
Quels ont été les principaux changements apportés par la loi de 1946 ?
La loi de 1946 a instauré le partage plus égalitaire des revenus agricoles, supprimé les corvées obligatoires, permis la conversion du métayage en fermage sur simple demande et a donné un droit de préemption aux exploitants agricoles landais.
Pourquoi y a-t-il eu des tensions lors de l’application de ces réformes ?
L’application de la réforme a suscité des conflits car elle remettait en cause les privilèges des grands propriétaires fonciers. Des meetings, des affrontements et des actions collectives ont eu lieu, en particulier à Pouillon et Narrosse, entraînant parfois des interventions policières.
Quels sont les liens entre la lutte des métayers landais et les enjeux sociaux actuels ?
La lutte pour la justice foncière dans les Landes trouve une résonance dans les débats contemporains sur l’accès aux droits, la répartition des richesses et la gestion des biens communs, tout comme les conflits actuels liés à l’immobilier ou à la migration.
Comment ce passé influence-t-il encore la société landaise aujourd’hui ?
Cet épisode a forgé une conscience collective autour de l’équité territoriale et de la solidarité rurale, qui se manifeste encore dans les débats sur la justice, l’identité locale et la gestion du patrimoine foncier.
Source: actu.fr